JOHANN STRAUSS (1825-1899)
Né à Vienne en 1825 de Johann Strauss (1804-1849), il devra attendre le divorce de ses parents pour commencer l’apprentissage de la musique à 17 ans : son père avait en effet interdit à ses enfants de suivre sa voie. Le surprenant à jouer du violon (il prenait secrètement des cours de violon et de piano, ce qui ne risque plus d’arriver aujourd’hui…), il lui donne le fouet pour le punir. On est devant l’inverse de la famille Bach, avec une rivalité inconciliable entre le père et le fils. Cela n’empêchera pas ses frères Josef et Eduard de suivre son exemple puis de l’épauler.
Afficher plusAyant composé sa première valse à l’âge de 6 ans, il forme dès ses 18 ans un orchestre de 24 musiciens recrutés à la taverne Zur Stadt Belgrad pour donner des concerts (à l’image de son père, et vite en concurrence : mais Johann I joue sa propre musique à Londres pour le Couronnement de la Reine Victoria en 1838 !). Au Casino Donmayer, le succès du fils devient retentissant lorsque l’une de ses valses est bissée 19 fois ! Il devient de facto le grand rival de son père, qui devient en 1846 directeur des bals de la cour au château de Schönbrunn, quand le fils devient en 1848 directeur de la musique municipale de Vienne.
Lors des secousses de la révolution de 1848, Johann II est arrêté pour avoir fait jouer La Marseillaise, alors que son père triomphe dans la monarchiste Marche de Radetzky ! Mais à la mort du père en 1849, Johann II réunit leurs orchestres et devient le fleuron de la monarchie autrichienne, rapidement nommé Hofballmusikdirektor. Ses tournées internationales triomphales à Paris, Berlin, Pétersbourg et Londres se succèdent, jusqu’à Boston où son Beau Danuble bleu est joué avec 1000 musiciens. On lui doit plus de 500 valses et polkas composées jusqu’à sa mort en 1899, et ses opérettes Le Baron tzigane et La Chauve-souris sont des piliers du répertoire.
On lui doit aussi une Napoleon Marsch en l’honneur de Napoléon III à l’occasion de la Guerre de Crimée (1854).
Admiré de Wagner, Brahms, Verdi et Richard Strauss, il laisse un patrimoine unique à la musique viennoise.
Bien que juif revendiqué, tout en étant parfaitement intégré à la société viennoise, le cas Strauss fut très compliqué à gérer pour les nazis. Le maire antisémite de Vienne Lueger dit à Hitler (qui adorait les valses de Strauss) : « c’est moi qui décide qui est juif ou pas ». Alors que ses œuvres auraient dû être interdites après 1938, le Reichskulturkammer (Ministère de la culture) effaça toute trace de l’hérédité juive des Strauss, et Johann II se vit décerner à titre posthume un certificat d’aryanité.
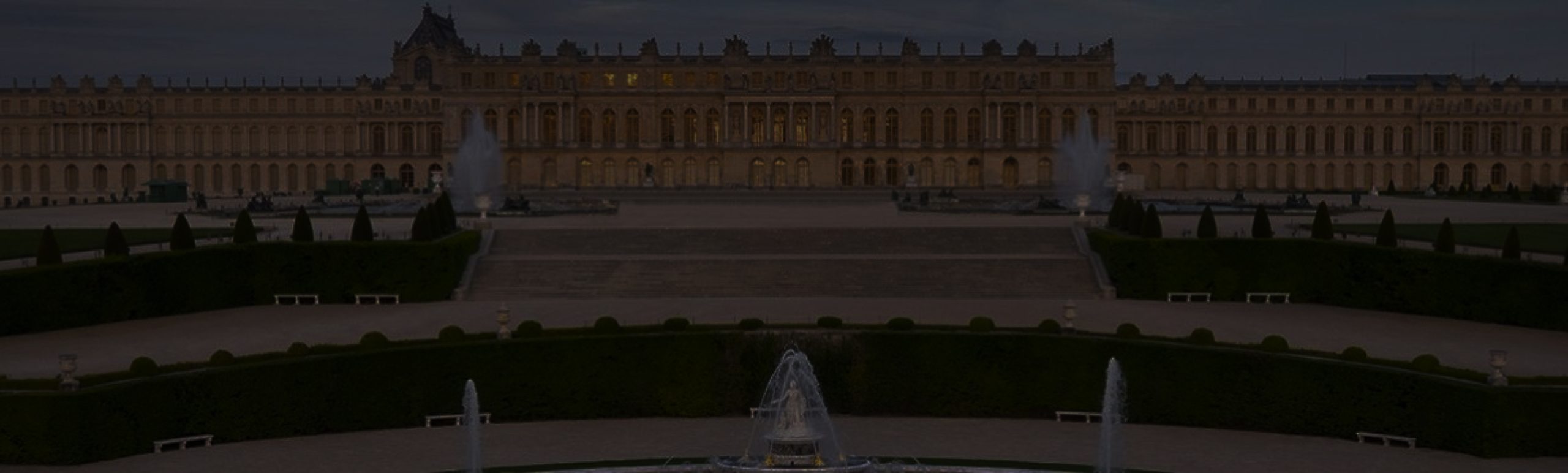









 Francais
Francais
 English
English
 soutenir
soutenir

